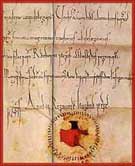| Début de la dynastie des capétiens (987 - 996) |
|
Accueil > Les Capétiens Directs > Début de la dynastie des capétiens |
 |
Hugues Capet, 1er roi capétien
|
Hugues Capet est élu roi par ses pairs en 987 suite à la mort accidentelle lors d'une partie de chasse de Louis V, dernier représentant de la dynastie des Carolingiens. Après son élection lors d'une assemblée de ducs et de comtes à Senlis et sur proposition de l'archevêque Adalbéron, il est sacré roi à Noyon et fonde ainsi la dynastie des Capétiens. Par extension, "capétien" désignera le
nom de cette dynastie royale, qui régnera en direct de 987
à 1328, puis par branches collatérales de 1328 à
1848 (sauf interruptions de la Révolution et de l'Empire
de 1792 à 1714). |
|
Hugues Capet est issu de la famille déjà prestigieuse des " Robertiens " : parmi ses illustres ancêtres, on peut citer :
Avant d'être élu, Hugues Capet cumulait les titres de comte de Paris et de duc des Francs. |
Anecdote Ce n'est qu'un siècle après sa mort que le surnom de "Capet" est donné à Hugues :
Par extension, " capétien " désignera le nom de cette dynastie royale qui régnera en direct de 987 à 1328 puis par branches collatérales de 1328 à 1792. |
Une France féodale
Après le règne de Charlemagne et particulièrement à partir de la fin du IXe, la royauté était devenue incapable d'assurer la paix : les invasions vikings ont particulièrement terrorisé la population. Cette perte de légitimité et de prestige de la royauté a directement bénéficié aux grands qui s'étaient révélés seuls à pouvoir assurer la sécurité de ceux qui se trouvaient sur leurs domaines.
De nouvelles relations entre les hommes vont apparaître dans ce contexte, donnant ainsi naissance à la féodalité :
-
Les ducs et les comtes :
A la tête du système féodal, on trouve une vingtaine de princes territoriaux, descendants des fonctionnaires carolingiens ou guerriers : ils détiennent des pouvoirs considérables souvent supérieurs à ceux du roi lui-même.
Parmi eux, on peut citer :
- les ducs de Bourgogne, de Normandie (à partir du tout début du XIe), d'Aquitaine,
- les comtes de Toulouse, de Flandre, de Champagne, de Boulogne.
- Les seigneurs possesseurs de châteaux-forts :
 |
Détenteur de domaines moins étendus, les possesseurs de châteaux-forts disposent de pouvoirs de justice et de commandement. Souvent vassaux d'un comte ou duc qui leur a concédé un fief, ces derniers ont en échange prêté hommage : il s'agit d'une cérémonie sanctionnant solennellement les liens de dépendance qui s'établissent entre le seigneur et le vassal. |
En échange, le vassal doit à son seigneur :
- une assistance militaire,
- un service de conseil,
- une aide financière dans les 4 cas suivants (qui évolueront au cours des siècles) : participation pour la rançon si le seigneur est fait prisonnier, lors du mariage de sa fille aînée, lors de l'adoubement de son fils aîné et lorsqu'il part en croisade.
Ces règles vassaliques étant relativement précaires, des luttes entre les féodaux généreront une instabilité, voire une situation d'anarchie transitoire.
|
La France vit donc pleinement sous le régime féodal : Au lieu d'appartenir au roi, le pouvoir est morcelé au profit de puissants seigneurs locaux qui lèvent des impôts, font la guerre ou rendent la justice eux-mêmes dans leur fief. La France est ainsi un puzzle de seigneuries. Pour illustrer ce manque d'autorité royale face aux seigneurs, on peut citer ce brutal dialogue, probablement imaginaire, qui aurait été tenu vers 990 par Hugues Capet et l'un de ses vassaux récalcitrants, Adalbert de Périgord : il témoigne de la fragilité de la dynastie capétienne à ses débuts :
|
En 987, ni la longévité ni la puissance de la dynastie naissante n'étaient donc prévisibles !
Un domaine royal bien limité
|
Les possessions directes du roi se trouvent réduites à un petit domaine dans l'Ile-de-France, entre Compiègne et Orléans (voir en bleu sur la carte). Dans le reste du territoire, correspondant à une soixantaine de nos départements actuels, l'autorité du roi est précaire et son pouvoir est illusoire. Il dispose également d'un réseau d'abbayes, dont Saint-Denis, Fleury ou Saint-Martin de Tours. Bien que suzerain (maître suprême) de ses vassaux, le roi ne peut s'imposer face à ses puissants feudataires (possesseurs d'un fief) qui sont en réalité quasiment indépendants car il souffre : |
|
- d'une puissance militaire très limitée malgré le service d'ost, qui est une sorte de "service militaire" dû par les vassaux au roi,
- d'une administration inexistante,
- de ressources financières trop limitées.
|
Hugues Capet doit concéder une partie de ses territoires à sa famille et aux grands seigneurs pour les remercier de son élection : l'ancien comte de Paris devient ainsi un roi relativement pauvre !
|
De plus, deux grands ensembles s'opposent au sein du royaume par leurs langues, leurs cultures et leurs origines ethniques : leur frontière relie Grenoble et Bordeaux :
|
|
A ces 2 langues s'ajoutent en fait de nombreux dialectes qui sont à l'origine de nos actuels patois ou langues régionales : l'éclosion de ces différents dialectes est amplifié par le système féodal avec son puzzle de seigneuries.
On constate donc que rien ne prédestinait la faible dynastie capétienne
à réunir sous son autorité un ensemble de territoires
qui sera à l'origine de la France.
Il est indéniable que l'élection de Hugues Capet s'explique
aussi par sa faiblesse relative, qui en fait un candidat peu dangereux
vis à vis de ses vassaux.
Le pays se développe lentement
Durant le règne d'Hugues Capet, le développement du royaume, bien timide, est servi par :
|
|
Les 1ers capétiens n'avaient pas encore de capitale attitrée et se déplaçaient de villa en villa : il faudra attendre Philippe Auguste pour que Paris devienne capitale du royaume.
Le sacre du roi et sa succession
Le roi dispose d'un atout majeur qui lui donne de l'autorité sur les autres seigneurs qui sont bien souvent plus puissants que lui : il est couronné et sacré par un évêque, et est ainsi reconnu comme roi de droit divin. Ce sacre religieux lui assure un pouvoir qui le distingue de ses vassaux et lui garantit un prestige incomparable.
Afin d'assurer une monarchie stable et la continuation de la dynastie, Hugues Capet va instaurer deux principes fondamentaux :
- l'association du vivant du roi du fils aîné au trône : nous verrons que cela va permettre de passer en douceur d'une royauté élective à une royauté héréditaire,
- le principe de la primogéniture : la priorité est accordée à l'aîné des enfants du roi, évitant tout conflit au sein de la famille royale (c'est ce qui a en partie causé la fin des dynasties mérovingienne et carolingienne).
Ainsi, cette faible dynastie va pouvoir perdurer sans conflit de succession et s'affirmer progressivement après la mort de Hugues Capet en 996 avec Robert II le Pieux, qui sera roi de 996 à 1031.
 |
Le roi et la justice Hugues Capet, que l'on voit assis sur son trône, tient la main de justice : les trois doigts sont le symbole de la Sainte Trinité qui confirme le pouvoir religieux du roi. La main de justice réunit ainsi la puissance justicière conférée au roi à sa puissance religieuse de par son sacrement.
|
 |

|
|